Avec F*cking Future, Marco da Silva Ferreira explore la standardisation des corps et l’autorité des normes dans une dystopie physique, érotique et politique. Entre exaltation queer, fiction militaire et tension scénique quadrifrontale, il interroge les récits dominants et cherche à fissurer, par le geste chorégraphique, les cadres imposés du présent.
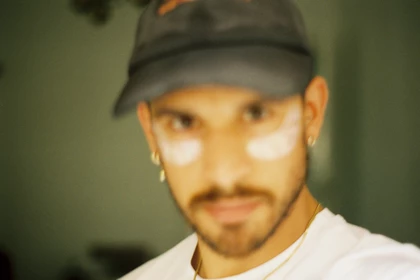
Des premières notes sur votre carnet aux répétitions, que reste-t-il d’important à questionner avec F*cking Future ?
M.S : L’uniformisation, la réplication de nos corps, de nos comportements. Dans mon travail chorégraphique, j’ai coutume de célébrer la diversité de mes interprètes, l’historicité de leurs corps ; je m’amuse à trouver une formule collective dans nos différences. Aujourd’hui, je prends un chemin inverse : comment ouvrir une disruption, une individualité dans un contexte standardisé, uniformisé.
D'où vient ce titre, très accrocheur ?
M.S : F*cking Future est un cri, un peu juvénile, très décomplexé. C’est un appel à la déchirure, qui marque une volonté de renouveau. Ce n’est pas une invitation à une révolution assassine, plutôt, un prisme un peu punk d’entrevoir des possibilités pour l’avenir. C’est un titre qui me met au travail de manière très positive.
Que souhaitez-vous déchirer dans notre présent ?
M.S : Ce sentiment pessimiste, cette incertitude qui se traduit souvent par « Qu’est-ce qu’on va faire ? ». Aussi, cette sensation d’être juste spectateur·rice d’une militarisation de la société, d’un retour au grand patriarcat, digne d’un passé que je préférerais oublier. Je pense par exemple à la dictature que nous avons vécu au Portugal. Je cherche à créer un pont, entre ce que j’expérimente dans la Grande Histoire et mon histoire intime. D’où cette réflexion sur la réplication des corps, leur standardisation au service d'une efficacité institutionnalisée. Cette injonction à l’efficience me trouble profondément et a ouvert un nouveau champ de recherche chorégraphique.
Vos performeur·euse·s seront dans un rapport quadrifrontal. Pourquoi ce choix très révélateur ?
M.S : Dès le début, je visionnais une relation spectateur·rice et performeur·euse proche de la clinique, d’observant·e / observé·e : en tant que spectateur·rice, j’examine, j’étudie un corps qui répète des actions, en effort physique constant, intense, comme un entraînement physique. Très vite dans le processus de recherche, cette perspective m’a engagé dans une introspection sur la masculinité et sa performance. Le quadrifrontal me permet d’envisager mes interprètes comme des présences hologrammiques, suspendues, en boucle, dans le vide, à la recherche d’un rendement ultime.
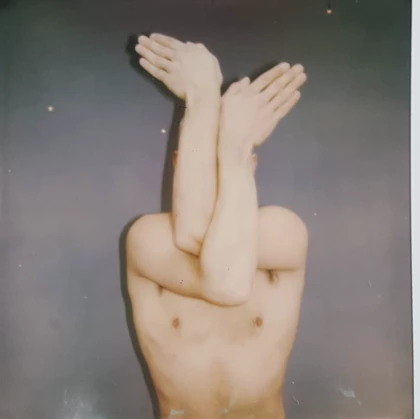
Comment cela se traduit dans votre approche du mouvement ?
M.S : Le vocabulaire que j’explore actuellement est celui du systématisme, du commando, de la hiérarchie, du compte. J’essaie de façonner un rapport à l’organisation, au groupe, comme à l’école ; et comment dans cette organisation, la binarité des genres s’exprime. Cela me replonge fortement dans mes souvenirs d’école secondaire.
Est-ce que F*cking Future vous permet une nouvelle expression de soi ?
M.S : Oui, en offrant une perception de mon identité queer dans mon travail ; en comprenant que l’exercice physique à l’école secondaire était pour moi un cadre d’affirmation, d’exploit et donc d’acceptation sociale de ma différence par mes camarades. Avec F*cking Future, je me permets aussi de mettre en discussion deux procédés d’actions sociales : d’un côté, le militarisme et de l’autre, la militance ; deux dispositifs qui nécessitent une même pensée martiale pour s’implémenter et provoquer du changement dans la société, bien qu’ils viennent de deux intentions diamétralement opposées. Cela vient de mes implications personnelles récentes et ce dont je suis témoin dans ma vie de tous les jours, avec le désir de faire dialoguer ces lignes de tensions et voir ce qui peut naître de leur friction. Il y a une grande part dédiée à l’éros aussi, dans la fétichisation des corps armés, policiers que l’imaginaire queer et gay a engendrés, et le besoin de les déconstruire.
Comment l’érotisme s'exprime dans cette pièce ?
M.S : C’est très difficile à nommer car qu’est-ce qui est vraiment érotique ? Cela dépend du prisme duregard, de la sensibilité individuelle, de l’endroit où les spectateur·rice·s seront physiquement dans la salle. Quelle est cette limite qui nous fait dire : ceci est érotique ou sexuel·le ? Un exemple pour F*cking Future : l'expression des corps dans les mouvements d’exercices physiques par exemple. Ce sont des corps très herculéens, ou au contraire, très lascifs. Il y a aussi un point de départ important dans ma fiction chorégraphique : il faut imaginer que Jeanne d’Arc, des drags, des pédés, ou Hercule auraient rejoint mon armée et qu’iels n’auraient pas eu d’autre choix que de se fondre dans le moule même si cela implique de mourir pour la cause ; c’est ça F*cking Future.
Et si Jeanne d’Arc arrivait le premier jour des répétitions, quel conseil lui demanderiez-vous ?
M.S : …(Silence)… Je lui demanderais quelle serait sa plus grande peur ?
Selon vous ?
M.S : Je dirais… le conformisme. Aussi, je lui demanderais comment était sa relation avec Gilles de Rais, cette figure déviante de la Guerre de Cent-Ans ? Dans la mythologie queer, iels font office de référence.
Et pour Hercule ?
M.S : ... son point faible.
Il me semble que la fragilité, la vulnérabilité, l’échec – ou l’envie d’explorer ces thèmes – s’invitent aussi dans ce nouveau travail ?
M.S : Dans le cadre du quadrifontral, je dirais que ces thèmes s’invitent dans la ligne de tension entre performeur·euse·s et regard du public. Les performeur·euse·s seront au centre de ce dispositif scénique, au centre d’un espace délimité où la visibilité du corps est décuplée, où tu es observé·e de tous les côtés. Cette surexposition à 360° crée de facto un état de fragilité et de vulnérabilité dans l’acte physique.
La musique accompagne ce rapport ?
M.S : Je suis très influencé par les synthés de Caterina Barbieri. Ce sont des partitions métalliques, saturées, dont la mélodie se crée à partir d’un système d’écho qui s’intensifie graduellement. Dans le travail de composition musicale, c’est intéressant de voir comment la culture techno européenne trouve ses origines mélodiques dans l’ère industrielle de l’après-guerre, comment art / armée / capitalisme dialoguent.
Dans ce règne de la performance et de la force, y-a-t-il de la place pour le silence ?
M.S : Le silence est dangereux. Il ramène au moment présent, à l’arrêt, à la contemplation, à la prise de conscience. Le silence est aussi une réponse physique à l’impact d’un son. Je l’utiliserais comme une ligne de contradiction avec le cœur physique principal du spectacle. Mes choix esthétiques vont dans ce sens d'ailleurs : je cherche à faire jaillir des pigments en rupture immédiate avec les tonalités environnantes.Comment d’un gris “sel d’argent”, comme celui des plaques photographiques, renforcé par un jeu de fumées, apparaît un rouge franc, la couleur d’un muscle, d’un œillet, d’un flash, d’un laser. Je cherche exactement cet essentialisme dans cette nouvelle création chorégraphique
