“La danse est une parole dans le corps” ; c’est ce qu’affirme la chorégraphe chercheuse Nacera Belaza. À l’occasion de sa nouvelle création L’Écho, pensée en collaboration avec la comédienne Valérie Dréville, elle revient sur sa quête de liberté intérieure, son rapport au réel, et cette prise de parole mystérieuse, sans mots, qui place le corps au centre de la scène et répare le monde.

De votre premier geste chorégraphique à aujourd’hui, que reste-t-il de vital dans votre travail ?
N.B : Créer un espace parallèle. Un lieu symbolique dans lequel le monde peut se réparer – et moi avec. C’est là depuis le début, cette nécessité de m’extraire du réel tel qu’il m’est imposé. Il ne me suffit pas. J’ai toujours ressenti un besoin d’outre-monde, d’un langage qui ne passe ni par les mots, ni par la simple physicalité du corps, mais par une sorte de langue enfouie, presque invisible. Mon travail s’est construit dans ce besoin vital d’aller ailleurs, de traverser, contourner, fissurer les contours du réel pour le réinventer – de l’intérieur.
Vous êtes venue à la danse après des études littéraires. Que vous a offert cette bascule ?
N.B : Une autre manière de sonder la nature humaine. Comme la littérature, la danse me permet d’interroger ce que nous sommes, mais par le corps. Cette bascule m’a menée vers une introspection radicale : comprendre mes mécanismes internes en observant les autres, en me déplaçant dans leurs corps, dans leurs peurs. Ce que je cherche, c’est une liberté intérieure. J’essaie de m’en approcher, de la partager avec les interprètes, avec le public. Mais ce n’est jamais gagné. Surtout dans une société qui dévalue l’art, fracture les individus. Tenir une compagnie indépendante aujourd’hui, c’est une forme de résistance. Alors je continue tant que ce feu intérieur – cette pulsion de vérité – reste plus fort que l’adversité.
Que trouve-t-on en allant chercher cette liberté dans les profondeurs de l’être ?
N.B : On rencontre ses enfermements : éducatifs, culturels, affectifs. Ce que j’observe, ce sont des comportements extrêmes, dans des situations extrêmes. Dans mes pièces, je construis des dispositifs où les peurs affleurent, où les zones d’ombre remontent. Peur du noir, du regard de l’autre, du vide, du silence... L’interprète se confronte à lui-même. Moi aussi. On devient des laboratoires sensibles. Et à travers cette mise en péril, on apprend. Le plateau devient un terrain d’expériences où l’on observe comment le corps parle, ce qu’il trahit, ce qu’il transforme.
Composer dans cet état de mise en péril, ça produit quoi ?
N.B : Une perte de repères. Une désorganisation des habitudes, des automatismes, une mise à nu. Je ne cherche pas à faire une « belle pièce ». Je cherche la vérité du corps, sa parole enfouie, sonder les strates profondes du corps, lire en lui. Pas dans les livres. Ce sont les corps qui me parlent. Tous les corps. Et je les écoute.

Vous dites : « La danse est une parole dans le corps ».
N.B : Oui. C’est une forme de prise de conscience, pour les danseur·euse·s comme pour moi. On croit souvent que la danse est une question de forme. Je pense que c’est avant tout une question d’écoute. Écouter ce que le corps dit, et pas seulement ce qu’il fait. Cette parole-là, quand elle est juste, elle devient contagieuse. Elle libère aussi celui qui regarde.
Votre duo avec la comédienne Valérie Dréville semble marquer une nouvelle étape.
N.B : C’est un début. Une première pierre. Valérie n’a pas les réflexes d’un·e danseur·euse : elle n’a pas pour habitude de s’exprimer sans mots, d’écouter exclusivement avec le corps. Elle avance dans un territoire inconnu. Et moi aussi. C’est très déstabilisant, donc très fertile. Je cherche toujours à me mettre en danger, à aller là où je ne sais pas faire. C’est le seul moyen, pour moi, d’ouvrir de nouveaux espaces.
Ce duo inaugure-t-il une nouvelle langue ?
N.B : Ce n’est pas une nouvelle langue, c’est la même – mais elle change de canal. On ne passe plus par le verbe, mais par la chair. Avec Valérie, ma langue est entendue. Ce que je cherche depuis longtemps – une parole qui remonte à travers le corps – trouve ici une résonance particulière. Je vis la rencontre avec Valérie comme un recentrage sur mon travail.
Le titre de la pièce, L’Écho, s'est inscrit en vous en cours de processus. Que représente-t-il ?
N.B : Je ne choisis jamais un titre. Il s’impose, comme une image qui remonte à la surface. Je dis souvent que le titre est une clé pour le·a spectateur·rice. Pas un résumé, pas une explication. Une tension. Un mot qui met en friction ce que l’on voit et ce que l’on ressent. Pendant toute la pièce, le public cherche ce que cet “écho” vient activer en lui. Et cette tension-là l’implique. Elle l’oblige à écouter.
Justement, quelle relation cherchez-vous à établir avec le public ?
N.B : Une relation d’écoute. Pas de regard. Le regard est trop fragile, trop passif. Quand on regarde, on reste à distance. Je veux qu’on écoute. Qu’on entre dans un état de perception active, multiple. Que tous les sens convergent vers le plateau. Et pour ça, il faut que les interprètes parlent, intérieurement. Qu’iels racontent. Car la danse, c’est aussi une manière de conter. Et le conte, c’est l’origine de tout art.
Quel récit émerge actuellement de vos répétitions-recherches ?
N.B : Peut-être celui-ci : une conférence dansée pour tenter de décrire, ce que jusqu’ici, j’ai toujours confié au geste, à l’espace, au silence. Décrire les fondamentaux de mon travail chorégraphique, les nommer, les penser à voix haute. Tenter d’appréhender une approche du mouvement comme nécessité intérieure, de l’écoute de soi, de l’autre. Comprendre le rôle essentiel que tiennent dans mes pièces les éléments scéniques que sont : le son, la lumière, l’espace vide, le·la spectateur·rice avec qui l’interprète construit une expérience partagée – comme dans un état de résonance. Cette conférence dansée sera donc aussi un geste. Celui de dire autrement, d’ouvrir : de donner à voir ce qui, souvent, se joue en creux – les lignes de force invisibles, les choix. Une façon de partager une recherche en donnant à voir et entendre le processus, les choix, les intuitions, les silences qui jalonnent la création d’une œuvre. Ce moment sera donc à la fois une conférence, la description d’un cheminement, un espace de mise en relation. Une forme nouvelle, où je m’expose et me relie à l’autre différemment, pour inviter le public à entrer dans l’intimité d’un geste artistique – non pas en tant que spectateur·rice d’un résultat mais comme témoin actif d’une recherche en mouvement.
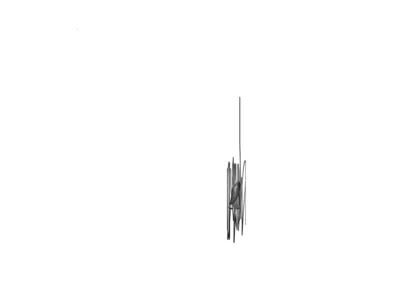
Retrouvez la conférence dansée de la chorégraphe en mars 2026 à La Raffinerie :
Nacera Belaza, Écrire l'invisible